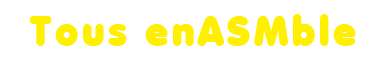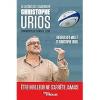Comment relancer un club en cinq mois : la mission délicate des entraîneurs appelés en cours de saison
Alors que Patrice Collazo vient d'entamer une mission de cinq mois pour relancer le Racing 92, 12e du Top 14, plusieurs entraîneurs passés par là expliquent comment utiliser un temps aussi court.
« Quand on réussit une de ces "opérations-commando", l'émotion est encore plus forte que quand on devient champion car, pendant des semaines, on a vécu avec la peur et enlever ça, ce n'est pas rien... » Christian Labit est un de ces entraîneurs-pompiers du Championnat de France de rugby, Top 14 et Pro D2 confondus, qu'on appelle à la rescousse quand tout va mal et qu'il s'agit, en cinq ou six mois, de sauver un club de la relégation. Il a connu ça à Narbonne, Aix-en-Provence, Carcassonne ou Montpellier, l'an passé.
Pareil pour Didier Faugeron qui, il y a une dizaine d'années, avait enchaîné en trois ans des missions sauvetage au Stade Français, Bayonne et Biarritz. « Vous avez composé le 18 pour me contacter ? », lâche-t-il, en riant de cette étiquette qu'on lui a collée malgré lui et en se remémorant son passage à Bayonne, de décembre 2011 à juin 2012.
« C'est très dur de partir après une aventure humaine aussi intense et, quand je recroise ces joueurs, on est encore unis par ces quelques mois. »
« Je n'étais là que pour six mois, Christian Lanta et Christophe Deylaud, les futurs entraîneurs, avaient signé un contrat de trois ans derrière, se remémore Faugeron. Bayonne avait six points de retard sur le premier relégable et, pendant deux mois, on n'a pratiquement pas bougé au classement. Pourtant, les joueurs tiraient tous dans le même sens et on a fini avec quatre points de plus que le dernier. C'est très dur de partir après une aventure humaine aussi intense et, quand je recroise ces joueurs, on est encore unis par ces quelques mois. »
Une aventure humaine, c'est ce que va devoir proposer Patrice Collazo, arrivé pour remplacer en urgence Stuart Lancaster au Racing 92, 12e du Top 14 avec seulement deux points d'avance sur le Stade Français et 6 sur Vannes, la lanterne rouge, qu'il reçoit ce samedi. « Il s'agit d'embarquer les joueurs sur un projet commun en leur redonnant l'envie d'être ensemble », estime Christian Labit. « Il n'y a pas de recette, ajoute Didier Faugeron, mais il ne doit y avoir qu'un seul discours et pas de parasite. Comme sur un talkie-walkie, on choisit un canal et on n'en bouge plus. Le temps est compté. »
La mission durera cinq mois. « C'est très court, raconte Pierre-Henry Broncan, parachuté dans les mêmes conditions à Brive l'an passé (pour justement remplacer Collazo), à la différence qu'il enchaînait ensuite sur un contrat de deux ans. Mais il n'y a pas de pression quand tu arrives comme ça, tu n'as pas le temps de réfléchir "club" et tu peux donc te concentrer uniquement sur le sportif et sur les matches. Tu n'as pas les soucis du long terme, quand tu es responsable des recrutements, des départs de certains joueurs ou des reconductions de contrat. C'est souvent là que les tensions arrivent. »
Arrivé le 3 février pour prendre ses fonctions, Collazo a dû faire vite. « La première chose, poursuit Broncan, c'est de faire un audit de l'effectif. Un point infirmerie, un point sur les Jiff, pour savoir sur qui tu peux compter exactement. Moi, j'avais déterminé une équipe-type pour les trois premiers matches. » Pas le temps de voir tout le monde en tête-à-tête et c'est en groupe que les joueurs vont exprimer ce qui ne va pas, certaines tensions parfois, des rancoeurs. « Il faut aller les chercher pour que ça sorte, décrit Faugeron, mais c'est essentiel pour repartir sur des bases saines. »
« Un entraîneur n'est pas plus pertinent tactiquement ou techniquement que des mecs à 50 sélections, il s'agit juste de redonner un élan, un autre état d'esprit, quelque chose de simple et de ludique. »
L'an dernier, à Montpellier, le trio Collazo-Labit-Etcheto s'était servi du Challenge européen comme d'un laboratoire d'expérience. Labit : « Pour faire jouer ceux qui n'entraient plus dans les plans, leur redonner confiance, remettre de la concurrence. Patrice pourra aussi se servir de ça avec le Racing (qui a été reversé en Challenge après avoir échoué à se qualifier en Coupe des champions). Mais une chose est sûre, un entraîneur n'est pas plus pertinent tactiquement ou techniquement que des mecs à 50 sélections, il s'agit juste de redonner un élan, un autre état d'esprit, quelque chose de simple et de ludique. On ne se rend pas compte mais, parfois, les joueurs souffrent de devoir être rigoureux en permanence, sur tout, toutes les semaines. »
Intégré au staff de Lyon en tant qu'entraîneur principal pour remplacer Jono Gibbes début décembre 2024, Karim Ghezal parle aussi de confiance et de simplicité : « La plupart des joueurs étaient stabilisés en termes de contrat mais certains n'étaient pas à 100 % de leur potentiel, comme les internationaux Dylan Cretin, qui ne jouait pas, ou Killian Geraci, qui était prêt à partir à cause de ce manque de confiance. Je les ai titularisés contre Toulouse pour essayer de changer ça. Il y avait aussi quelque chose de pesant, comme si l'énergie n'était pas mise au bon endroit. J'ai simplifié au maximum, réduis les réunions, les vidéos et supprimé les données statistiques, les fiches comparatives entre les joueurs. Cela individualise trop la performance. »
Les leviers d'action, de l'avis de tous ceux qui ont vécu de tels scénarios, sont peu nombreux et ne concernent pas le rugby en réalité. Joueur à Montpellier l'an dernier, l'arrière Anthony Bouthier a connu l'éviction de deux managers, Xavier Garbajosa en janvier 2021 et Richard Cockerill en novembre 2023 : « L'apport d'un nouveau staff est plus mental que technique, constate-t-il. Il y a une forme d'électrochoc qui se produit entre les joueurs ; ceux qui jouaient moins voient une occasion de se relancer, ceux qui jouaient plus se disent qu'ils vont être en danger... Et cette émulation peut faire du bien. »
« C'est plus facile de virer un coach que 40 joueurs mais nous, on se sent fautif. On fait perdre un boulot à une personne, ce n'est jamais agréable... »
Anthony Bouthier, joueur à Montpellier l'an dernier
Il parle aussi d'une envie commune de se retrouver autour de quelque chose de positif dans un moment morose : « C'est plus facile de virer un coach que 40 joueurs mais nous, on se sent fautif. On fait perdre un boulot à une personne, ce n'est jamais agréable... »
« Quand l'entraîneur était apprécié mais que les résultats ne suivaient pas, il y a généralement une prise de conscience du groupe, souligne Julien Arias, devenu entraîneur au Stade Français au moment où il arrêtait sa carrière et désigné, avec Laurent Sempéré, pompier de service après le limogeage du Sud-Africain Heyneke Meyer en 2019. Comme le départ était voulu par le groupe, c'était plutôt une libération, surtout qu'on bénéficiait avec Laurent de la bienveillance de ceux qui étaient encore nos partenaires quelques mois ou semaines plus tôt. Il faut poser un cadre et être à l'écoute mais, conclut-il, ce sont les joueurs qui ont la solution. »